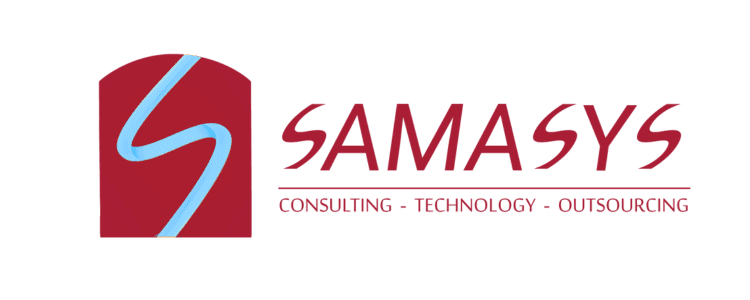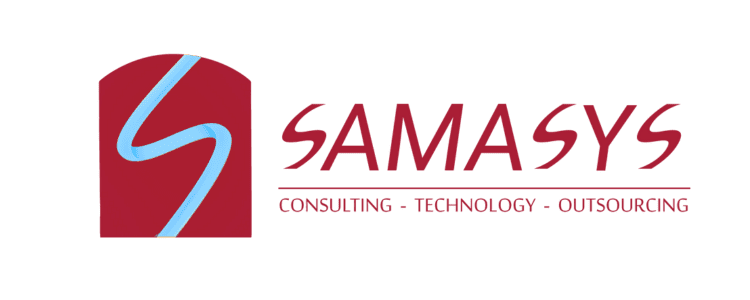1. Définitions : de quoi parle-t-on exactement ?
Télétravail, remote work, travail à distance… autant de termes qui désignent une réalité devenue quotidienne : celle d’un travail effectué hors des locaux habituels de l’entreprise, souvent à domicile, parfois dans des espaces tiers, ou même depuis un autre pays. Le mot « télétravail » est d’origine française, institutionnelle, utilisé dans les contextes publics et juridiques. Le terme « remote work », plus récent et anglo-saxon, est porté par l’économie numérique et le monde des startups.
En Tunisie, les deux termes coexistent et renvoient à des réalités multiples.
2. Une dynamique de réforme à saluer, mais encore incomplète
La Tunisie a récemment amorcé une modernisation progressive de son droit du travail, à travers l’adoption de textes portant sur le statut de l’auto-entrepreneur, La réforme des contrats de travail et l’interdiction de la sous-traitance de la main d’œuvre. Cette dynamique reflète une volonté d’adapter les règles aux mutations du marché de l’emploi. Pourtant, le télétravail reste à ce jour une initiative inachevée de la législation tunisienne.
Le télétravail étant donc défini comme toute forme d’organisation dans laquelle un travail qui aurait pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est réalisé à distance, de manière volontaire, en s’appuyant sur les technologies de l’information et de la communication.
Si le secteur public tunisien s’est doté d’un cadre spécifique (Décret présidentiel n°2022-310 du 5 avril 2022), applicable aux agents de l’État, des collectivités locales et des entreprises publiques, aucune réglementation équivalente n’a encore été mise en place pour le secteur privé. Toutefois, rien dans les textes existants ne l’interdit formellement. Le télétravail est donc possible, à condition de s’appuyer sur la législation générale (Code du travail, conventions collectives) et de formaliser un cadre clair entre les parties.
Dans ce contexte, chaque entreprise tunisienne est libre de structurer sa propre politique de télétravail, selon ses ressources, ses contraintes et ses objectifs. Deux outils sont particulièrement recommandés :
-
- Une charte interne, applicable collectivement à l’ensemble des salariés concernés, définissant les conditions et règles générales ;
-
- Un avenant individuel au contrat de travail, adapté à chaque salarié et précisant les modalités pratiques : rythme, lieu, horaires, équipements, etc.
Il en sort trois principales bonnes pratiques, réglementées dans un certain nombre de pays à savoir:
-
- Le volontariat : le télétravail ne peut être imposé, il doit résulter d’un accord mutuel entre salarié et employeur.
- La réversibilité : une période d’essai ou de réévaluation peut être prévue, permettant à l’une ou l’autre des parties de revenir au travail sur site si nécessaire.
- L’adéquation au poste : seules les fonctions réellement réalisables à distance peuvent être concernées. Certains métiers – maintenance, logistique, accueil, etc. – nécessitent une présence physique.
Enfin, le télétravail ne s’improvise pas : il suppose un minimum de préparation technique (connexion fiable, équipement sécurisé, outils collaboratifs) et de rigueur organisationnelle (sécurité informatique, planification, suivi managérial). Pour en tirer les bénéfices sans créer de déséquilibres, chaque entreprise doit définir une stratégie claire, cibler les postes concernés, accompagner les équipes, et anticiper les impacts RH, juridiques et techniques.

3. Le télétravail : parenthèse post-Covid ou normalité structurelle ?
Les chiffres internationaux sont parlants : près de 30 % des jours travaillés en Europe le sont à distance (contre moins de 5 % avant la crise sanitaire). Le modèle hybride (1,3 à 1,9 jour par semaine selon les pays) devient la norme. Au Royaume-Uni, 58 % des salariés préféreraient démissionner plutôt que de revenir en présentiel à temps plein.
4. En Afrique, un développement inégal mais croissant
-
- Le Maroc dispose d’une loi spécifique (n°55-19) et 35 % des entreprises y pratiquent le télétravail de manière permanente.
- En Afrique du Sud, le taux est de 50 % pour les fonctions de bureau.
- Le Nigeria voit se développer le freelancing et le travail distant malgré une infrastructure encore fragile.
- Le Sénégal se distingue par une cybersécurité solide mais un cadre juridique encore embryonnaire.
L’écosystème du remote africain se structure via des plateformes RH (Remote, PaySpace, Deel…), tirant parti d’une main-d’œuvre qualifiée à coût compétitif.
5. Pourquoi le télétravail doit être encadré
L’absence de réglementation encadrant le télétravail dans le secteur privé crée une zone grise préjudiciable, tant pour les employeurs que pour les salariés : horaires de travail flous, difficultés d’évaluation de la performance, incertitudes en cas d’accident du travail, risques de conflits juridiques ou managériaux, etc. À la différence du secteur public, où le télétravail bénéficie d’un cadre réglementaire spécifique, le secteur privé reste souvent dépendant d’accords internes ou de pratiques informelles. Cette absence de cadre formel peut fragiliser l’organisation du travail et impacter la productivité, la qualité des relations professionnelles ainsi que la protection juridique des deux parties.
6. Responsabilité du salarié : autonomie et maturité professionnelle
Le télétravail repose sur la confiance et la responsabilité. Certaines entreprises réalisent des entretiens d’éligibilité ou des tests comportementaux (DISC, MBTI) pour évaluer la capacité à travailler à distance. La productivité se mesure par les résultats, les livrables, les délais, et non par la surveillance
7. En Tunisie : que peuvent faire les entreprises ?
En l’absence de loi, les entreprises peuvent prévoir :
-
- Un avenant au contrat (lieu, horaires, fréquence, réversibilité).
- Une charte interne : éligibilité, matériels, suivi, rôle du manager.
- Des mesures de prévention : attestation du domicile, protocole accident, inclusion des télétravailleurs dans la politique RH.
9. Et maintenant ? Vers un modèle tunisien du télétravail
Les enseignements de nos voisins africains et européens offrent des pistes concrètes pour la Tunisie. Il ne s’agit pas de copier, mais d’adapter. En créant un cadre juridique, en soutenant les entreprises et en protégeant les travailleurs, la Tunisie pourrait faire du télétravail un levier de compétitivité, d’inclusion, et de bien-être au travail.
Ce contenu est fourni à titre informatif et ne remplace pas un conseil juridique personnalisé. Pour toute situation spécifique, n’hésitez pas à nous contacter : notre équipe est à votre disposition pour vous accompagner efficacement dans toutes vos démarches de conformité au droit social.