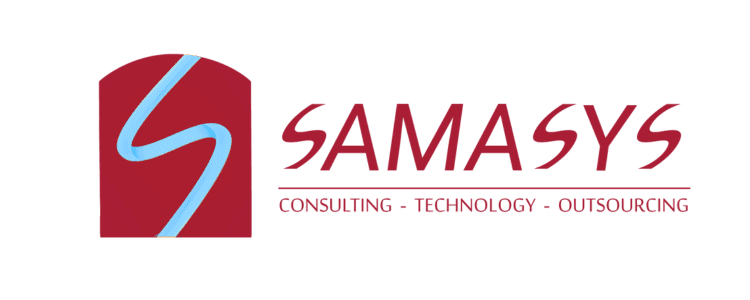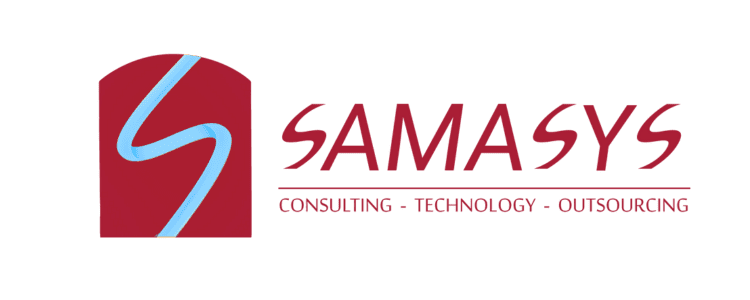« Derrière chaque heure, une vie » Pour un management du temps de travail plus humain et plus libre »
- 14 octobre 2025
- Envoyé par : admin
- Catégorie: Actualités
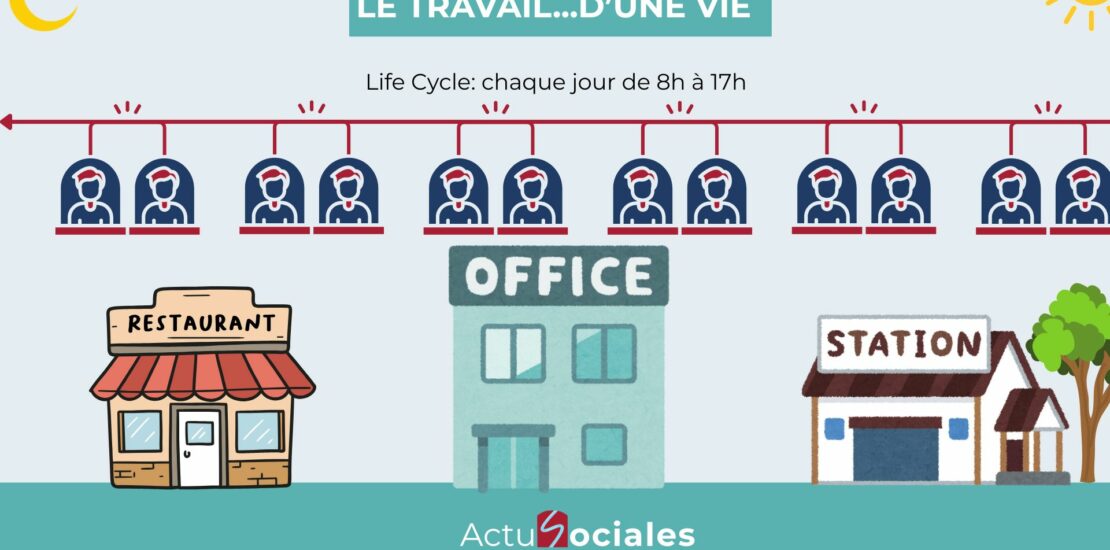
I. Préface – Derrière chaque heure, une vie
Les vacances viennent de s’achever. Elles ont filé — comme toujours. Et si, au lieu de reprendre le rythme d’avant, nous envisagions que cette parenthèse s’étire autrement ?
En tant que spécialistes de l’outsourcing paie, nous comptabilisons chaque mois des milliers d’heures de travail d’hommes et de femmes, pour les convertir en salaires.
Au fond, ce sont des vies entières que nous voyons défiler sous forme de chiffres et de paramètres. Et, en tant qu’entreprise profondément humaine, nous ne pouvons-nous empêcher d’imaginer celles et ceux qui se cachent derrière ces bulletins :
- Une mère célibataire qui jongle entre deux enfants et un poste à plein temps
- Un quinquagénaire qui fait deux heures de route chaque jour pour rejoindre son lieu de travail
- Un jeune passionné qui rêve que ses journées soient plus longues pour en faire toujours plus
Pourtant, malgré leurs réalités si différentes, ces personnes se voient imposer un rythme de vie uniforme, articulé autour d’un même noyau d’heures de travail.
Nos logiciels de paie, avec leurs règles standardisées, reproduisent ce schéma des milliers de fois. Un jour, nous aimerions pouvoir comptabiliser des heures de travail qui respectent la singularité de chacun :
- Des horaires qui tiennent compte des urgences de la vie
- Des organisations qui laissent une place à la liberté individuelle
- Des temps de repos qui reconnaissent les efforts fournis
Certes, cela rendrait notre tâche plus complexe… Mais quel plaisir de savoir que le temps de travail ne serait plus seulement une contrainte, mais un outil de respect et de bien-être pour chaque personne.
Et si on repensait le temps de travail ?
On parle souvent de “temps de travail” en termes de volumétrie : 35 heures en France, 40 heures ailleurs, 48 heures dans certaines conventions collectives tunisiennes. Mais au-delà de ce chiffre, que dit réellement l’organisation du temps de travail de notre rapport au monde, à notre liberté et à notre productivité ?
Pourquoi travaillons-nous huit heures par jour, cinq ou six jours par semaine ? Pourquoi est-ce la journée continue, et pourquoi commence-t-elle en général à 8h pour finir à 17h ? Pourquoi est-ce le dimanche qui a été consacré comme jour de repos, et non un autre jour ?
Ces questions, rarement posées, nous ramènent aux origines du management du temps :
- Héritage de la révolution industrielle, qui a normalisé la journée de travail autour de la fameuse règle 8h de travail / 8h de loisirs / 8h de repos.
- Héritage religieux et culturel, où le repos dominical a été consacré par l’Église puis inscrit dans les lois sociales.
- Héritage économique et militaire, qui a privilégié des horaires homogènes pour des raisons d’efficacité collective.
Mais dans un monde où la productivité est de plus en plus décorrélée du présentiel, où les bureaux sont climatisés, où les outils numériques permettent l’asynchrone et où la frontière entre vie professionnelle et vie personnelle se brouille, ces modèles sont-ils toujours pertinents ?
La réflexion de Karl Marx sur l’aliénation reste d’actualité : en conditionnant nos vies à un schéma fixe, nous perdons une part de maîtrise sur notre temps, notre énergie et notre santé mentale.
Car le temps de travail n’est pas seulement les heures passées au bureau :
- Ajoutons-y les temps de trajet, qui transforment une journée de “8 heures” en une journée de 10 heures sous la contrainte professionnelle.
- Ajoutons-y la charge mentale de devoir concilier les horaires fixes avec les impératifs familiaux : déposer les enfants, aller aux rendez-vous administratifs, gérer les urgences.
Le temps de travail finit par structurer toute notre vie : il détermine quand nous mangeons, quand nous dormons, quand nous voyons nos proches. Il impacte notre santé physique (stress, fatigue chronique) et même celle de nos enfants.
Pourtant, la majorité d’entre nous le considèrent comme un fait subi, un paramètre exogène qu’il faudrait seulement accepter. Les chefs d’entreprise, eux aussi, subissent ce stéréotype organisationnel : ils savent parfois que certains horaires sont contre-productifs, mais sans innovation managériale ou cadre légal alternatif, ils sont contraints de reproduire les mêmes modèles.
Rapport au temps : une question de perception
Le temps de travail est avant tout une expérience subjective. Certains salariés aimeraient que la journée fasse 48 heures — ils aiment leur travail, s’y épanouissent, voient leur productivité comme une source d’énergie. Pour d’autres, les huit heures réglementaires paraissent interminables.
Une typologie simple peut être utile :
- Les passionnés : ils vivent leur travail comme un projet de vie et le temps s’accélère.
- Les disciplinés : ils respectent le temps de présence mais attendent la sortie avec régularité.
- Les désengagés : ils multiplient les échappatoires pour « tuer le temps ».
L’enjeu n’est pas de rallonger ou de raccourcir le temps de travail, mais d’améliorer la qualité de l’expérience vécue.
Repenser le temps de travail – un mouvement mondial
Cette réflexion n’est pas qu’un exercice philosophique : dans de nombreux pays, des expérimentations sont en cours.
- Royaume-Uni & Islande – Tests à grande échelle de la semaine de 4 jours avec maintien du salaire. Résultat : baisse du stress, hausse de l’engagement et aucune perte de production.
- Espagne – Programmes pilotes subventionnés pour réduire le temps hebdomadaire à 32 heures.
- Pays nordiques – Adoption massive des horaires flexibles et du télétravail hybride.
- États-Unis – Montée en puissance du “Results Only Work Environment” (ROWE) : seul le résultat compte.
- Afrique du Sud & ?? Kenya – Réflexions sur les temps de trajet et mise en place de journées compressées pour réduire la congestion.
Ces initiatives montrent qu’on ne parle plus seulement d’augmenter ou de réduire le nombre d’heures : il s’agit de repenser l’organisation même du travail.
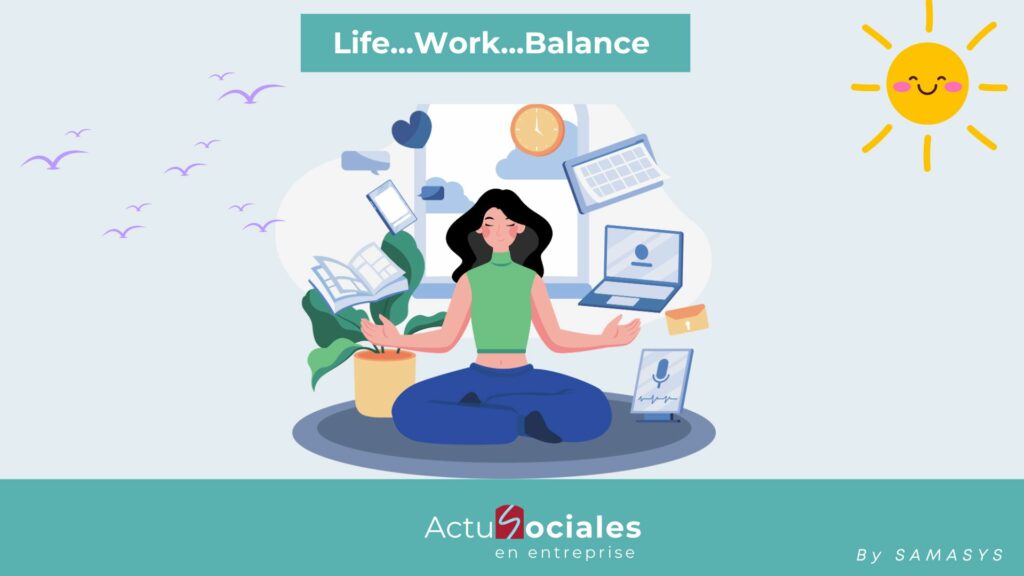
Et si on suivait le rythme du soleil ? Je rêve d’un modèle où l’on travaillerait au rythme de la lumière naturelle :
- Commencer tôt, au lever du soleil, et concentrer les activités à forte valeur ajoutée jusqu’à midi.
- Reprendre en début d’après-midi, mais sur des tâches plus légères, créatives ou collaboratives.
- Laisser la fin de journée libre pour la famille, les projets personnels ou le repos.
Peut-être qu’en 2050, nous regarderons nos journées de 8 heures comme un vestige de l’ère industrielle.
Conclusion : le temps, une ressource partagée
« Il faut donner du temps au temps », disait un vieil ami maltais de mon père. Dans un monde où tout s’accélère, apprendre à utiliser le temps avec justesse est un levier stratégique.
Pour les entreprises, cela signifie repenser les horaires, formaliser des politiques claires et expérimenter des modèles innovants. Pour les salariés, c’est reconnaître la valeur du temps passé au travail — et faire en sorte qu’il compte.
La rentrée n’est donc pas qu’un retour au bureau : c’est une opportunité de réinventer notre rapport au temps pour que chaque heure soit plus qu’une contrainte — une contribution à un projet collectif.