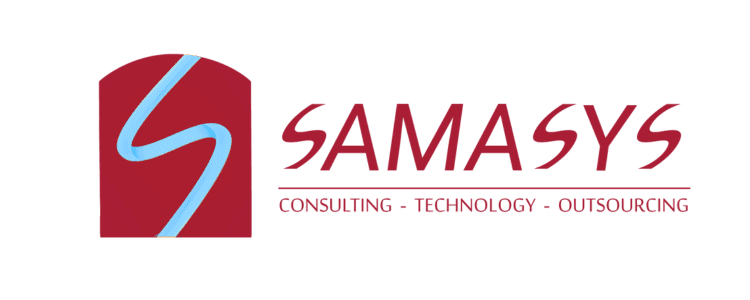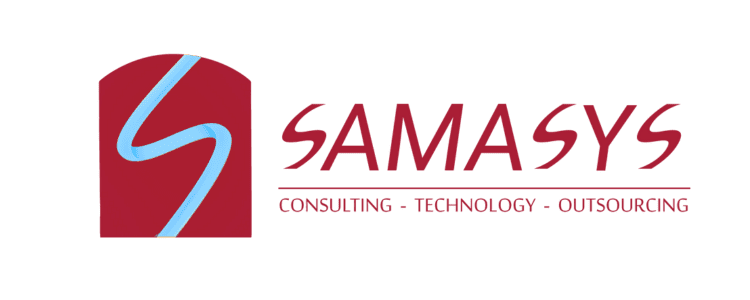QUID NOVI : L’interdiction de la sous-traitance de main-d’œuvre entre protection des salariés et zones d’interprétation
- 14 novembre 2025
- Envoyé par : admin
- Catégorie: Actualités
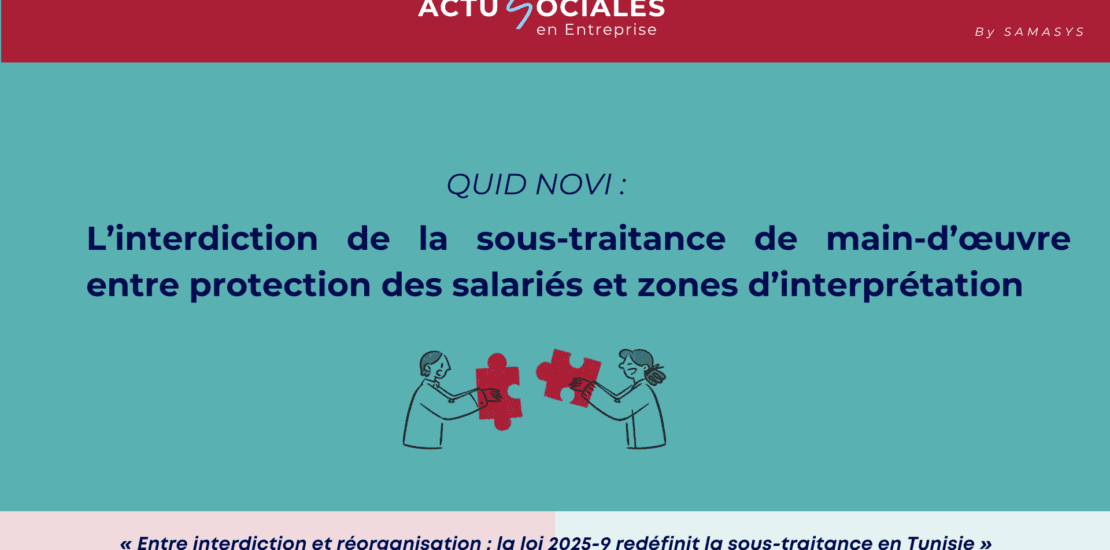
I. Comprendre le cadre : une réforme majeure aux effets transversaux
La réforme du Code du travail opérée par la loi n°2025-9 introduit un tournant structurant dans la manière dont les entreprises tunisiennes pourront recourir à des tiers pour exécuter des activités ou mobiliser des ressources humaines.
L’objectif affiché du législateur semble clair : protéger le salarié contre la précarisation et limiter les abus liés à la mise à disposition de personnel. Mais au-delà de l’intention du législateur, la lecture de la loi soulève d’importantes questions d’interprétation, notamment pour les entreprises de consulting ou de travaux ou de services spécialisés, dont le modèle repose sur l’exécution d’une mission ou d’un ouvrage, et non sur la mise à disposition de main-d’œuvre.
II. Les nouveaux équilibres instaurés par la réforme
La loi institue une architecture simple dans sa formulation, mais complexe dans ses implications pratiques :
- La règle générale : l’instauration du principe d’interdiction absolue de la sous-traitance de main-d’œuvre.
- L’exception encadrée : l’autorisation « Sous réserve du respect des conditions intrinsèques » de la sous-traitance de main d’œuvre, mais sous une nouvelle appellation qui devient désormais « contrat de prestation de services ou de fourniture de travaux. »
Autrement dit, si la mise à disposition de personnel est désormais interdite en principe, elle peut néanmoins être envisagée dans un cadre précis, à condition de respecter un certain nombre de critères cumulatifs.
III. Une exception encadrée, mais circonscrite à un champ précis
Il apparaît que le législateur a souhaité encadrer, sans l’étendre, l’exception au principe d’interdiction de la sous-traitance de main-d’œuvre.
Trois conditions majeures encadrent désormais cette pratique :
- La fourniture de services ou de travaux nécessitant des connaissances professionnelles ou une spécialisation technique au profit de l’entreprise bénéficiaire, et
- À condition que ces services ou travaux ne relèvent pas de l’activité principale et permanente de l’entreprise
- Les travailleurs employés ne soient pas sous la direction et le contrôle de l’entreprise bénéficiaire.
On peut en déduire que le législateur tunisien, à travers cette réforme, vise principalement à prévenir la substitution déguisée d’un employeur par un autre, source de précarisation et de contournement du droit du travail. Cependant, la réforme n’interdit pas la collaboration interentreprises ; elle impose en revanche une vigilance accrue quant à la réalité du lien de subordination et à l’objet économique du contrat.
Cette approche traduit la volonté du législateur de sécuriser les relations de travail tout en préservant la fluidité économique des échanges entre entreprises.
IV. Ouvrage & mission : les fondements contractuels du louage d’ouvrage en droit tunisien
En droit tunisien, les contrats d’entreprise s’inscrivent dans le régime général du louage d’ouvrage ou de services, tel que défini aux articles 828 et suivants du Code des obligations et des contrats (COC).
Ce régime distingue deux catégories principales :
- Le louage de services, par lequel une personne s’engage à fournir ses services personnels, pour une durée ou une tâche déterminée, moyennant rémunération ; et
- Le louage d’ouvrage, qui suppose l’exécution d’un ouvrage ou l’obtention d’un résultat défini, sous la direction et la responsabilité du prestataire.
Dans les deux cas, le contrat naît du consentement mutuel des parties, mais leur finalité économique diffère sensiblement. Le louage de services repose sur la mise à disposition d’un savoir-faire ou d’une compétence, tandis que le louage d’ouvrage s’articule autour de la réalisation d’un résultat concret et mesurable.
Sur le plan pratique et économique, cette distinction revêt aujourd’hui une importance particulière. Dans les secteurs du conseil, de la construction, de la maintenance industrielle ou encore des services informatiques, le recours au louage d’ouvrage permet aux entreprises de mobiliser des expertises spécifiques sans pour autant recourir à la mise à disposition directe de main-d’œuvre, désormais strictement encadrée par la nouvelle législation.
La notion de mission, en droit tunisien, s’inscrit pleinement dans cette logique. Elle désigne un ensemble cohérent de travaux ou de prestations confiés à un prestataire agissant de manière autonome pour atteindre un résultat défini contractuellement.
Cette mission peut inclure la fourniture de matériaux, d’équipements ou de moyens techniques, intégrés à la réalisation de l’ouvrage, tout en laissant au prestataire la responsabilité directe de la qualité et de la conformité du travail exécuté.
Ainsi, la mission ou l’ouvrage se distinguent clairement des contrats de prestation de services ayant pour objet principal la mise à disposition de personnel catégorie expressément visée par la réforme du Code du travail.
D’un point de vue économique, cette distinction vise à préserver la souplesse contractuelle nécessaire à l’activité des entreprises, tout en encadrant plus strictement les pratiques assimilables à la sous-traitance de main-d’œuvre, afin de garantir un équilibre entre flexibilité et sécurité juridique sur le marché du travail.
V. Conclusion
En conclusion, la réforme tunisienne exprime la volonté du législateur de prévenir toute précarisation des salariés en instaurant une interdiction absolue de la sous-traitance de main-d’œuvre. Elle n’affecte toutefois pas les contrats d’entreprise autonomes, dont l’objet, librement déterminé par les parties, ne consiste pas en une mise à disposition de personnel. Les entreprises peuvent ainsi exécuter leurs obligations contractuelles légitimes tout en respectant le cadre strictement défini par la loi.